Cette œuvre est
à retrouver dans nos collections
Nouvelles - Littérature Générale
Collections thématiques
- Nouveau Départ

Il y avait beaucoup de journées comme celle-ci. Des journées durant lesquelles je devais rester assis à mon bureau, face à ces trois écrans qui me tenaient en otage. Des journées durant lesquelles je radotais toujours les mêmes tâches qui peinaient à mobiliser ne serait-ce qu'un neurone. « Au moins tu as un boulot ! » me répétait sans cesse ma mère. C'était ma mère, elle avait toujours raison, enfin presque. Quand elle me disait que fumer des cigarettes n'était pas bon pour ma santé et mon bien-être, je n'étais absolument pas d'accord avec elle. « La cigarette me maintient en vie ! » lui disais-je avec un aplomb déconcertant. D'ailleurs, j'avais pris la décision judicieuse d'une pause clope ce jour-là. J'ai prétexté une envie pressante d'aller aux toilettes auprès de mes trois ravisseurs pour m'esquiver. Fumer était mal vu dans mon organisation, ils avaient même fait une affiche à cet effet sur laquelle nous pouvions lire : « Fumer TUE la productivité. » L'idée que fumer pouvait tuer des êtres humains restait secondaire, nous étions facilement remplaçables.
Il n'y avait pas un bruit dans le bureau, je n'étais pourtant pas le seul captif. Les écrans avaient pris le contrôle de tout l'étage. Les talons de mes boots claquaient sur le parquet et ce chuintement résonnait dans tout l'open space. Personne ne prenait le risque de lever la tête, il n'y avait que ces innombrables écrans qui semblaient pivoter dans ma direction, surpris de me voir en mouvement. J'ai ouvert l'immense porte typique de ces immeubles haussmanniens et emprunté l'escalier en chêne grinçant, tapissé de son étoffe rouge sanguinolent. En descendant les trois étages qui me menaient à la délivrance, je me suis pris à penser à tous ceux qui l'avaient arpenté avant moi. À ceux qui l'avaient gravi lors de leur premier jour et à ceux qui l'avaient dégringolé lors de leur dernier. À ceux qui l'avaient escaladé dans la réussite et à ceux qui l'avaient dévalé dans l'échec. Je me suis rapidement trouvé devant une seconde porte, encore plus imposante que la précédente, la dernière avant mon émancipation. Je l'ai ouverte en tirant de toutes mes forces pour me glisser sur le trottoir, contre le mur, afin d'éviter de perturber la circulation des Parisiens qui galopaient sous les coups de fouet de leur quotidien asservissant.
Mon paquet de cigarettes était encore vierge, je l'ai empoigné pour décrocher délicatement la languette de l'emballage plastique. Aucune poubelle à l'horizon, j'ai donc plongé le déchet dans la poche arrière gauche de mon pantalon dans l'attente de croiser un réservoir à ordures. Ensuite, c'était au tour du couvercle que j'ai soulevé avec plus d'empressement pour arracher d'un coup sec le dernier paquetage en aluminium. J'ai sorti la tige qui se trouvait au milieu du premier rang. Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier, aimais-je à penser. J'ai humidifié mes lèvres, porté la sèche empoisonnée à ma bouche en l'accompagnant d'un léger mouvement de tête vers la flamme libératrice de mon briquet. Une première taffe. J'ai inspiré profondément, coincé le nuage toxique dans mes poumons et exalté ce moment en expirant longuement. Je respirais enfin. J'ai repris vie et changé d'attitude. Je n'étais plus un mec soumis à son boulot, plus un esclave des machines et de leurs algorithmes. J'étais Richards, j'étais Hendrix, j'étais Osbourne, j'étais Morrison, j'envoyais le monde se faire foutre.
Un type est sorti de sa Porsche fraîchement garée, l'air hautain, il a porté son regard dédaigneux à mon endroit. Ses yeux m'ont dit : « Pauvre type, tu t'empoisonnes la santé pour supporter un boulot minable. » et les miens ont rétorqué : « Pauvre con, tu viens de te garer sur une place réservée aux handicapés. » Il est entré se faire lustrer dans la boutique d'à côté, c'était le genre de boutique où un tee-shirt coûtait la modique somme de 350 euros. Et puis, il y avait ce clochard adossé à la devanture du luxueux bazar. La mise en scène paradoxale typique que seul notre modèle de société pouvait réaliser. Il avait cette fierté bien placée qu'offrait la véritable modestie. Ce clochard a porté son regard empli d'espoir à mon encontre. Ses yeux m'ont dit : « Tu n'as pas une clope pour un pauvre type ? » et les miens ont rétorqué : « Je ne comprends pas ce que tu me veux. Je ne suis qu'un pauvre con. »
Ma cigarette avait déjà joué la moitié de sa pièce et j'avais décidé de me consacrer pleinement aux derniers actes. J'ai fermé les yeux pour faire abstraction du monde, je ressentais chacune de mes cellules pulmonaires se détériorer. Une aspiration. Le tabac se consumait comme la mèche d'une dynamite prête à exploser. Une taffe. Les picotements dans ma gorge m'épargnaient de la moindre parole superflue. Une bouffée. L'asphyxie progressive me redonnait un souffle de liberté. Un moment hors de l'espace et du temps. Il n'y avait ni bureau, ni écrans, ni pauvre type, ni pauvre con, ni clochard, ni même moi.
Le brûlant baiser du mégot atrophié m'a rappelé rapidement à ma situation. J'avais aspiré plus que la cigarette ne pouvait offrir. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé à nouveau sur ce trottoir, contre le mur, face à la foule au dos lacéré. Le gars hautain était sorti de la boutique, hagard, il tournait sa tête dans tous les sens telle une buse aux aguets. La place réservée aux handicapés venait d'être débarrassée de sa Porsche. Il a porté son regard haineux en ma direction et ses yeux rougeoyants m'ont dit : « Tu aurais pu me prévenir, pauvre con. » et les miens ont rétorqué avec dédain : « Tu aurais mieux fait de te garer ailleurs, pauvre type. » Le mec à la Porsche s'est mis à courir après le camion de la fourrière en crachant des injures et en agitant ses bras tel un naufragé sur île déserte. Le clochard adossé à la devanture se marrait d'une manière si communicative qu'il m'avait extrait le premier sourire de la semaine. Nous étions vendredi. Vaut mieux tard que jamais, avais-je médité. Ses yeux, baignés par les larmes de l'euphorie, se sont portés vers moi et m'ont dit : « Bien fait pour sa gueule ! Dis, tu n'aurais pas une clope pour un pauvre type ? » et les miens ont rétorqué avec remords : « J'arrive. Fais donc une place pour un pauvre con. » J'ai sorti deux sèches de mon paquet, une pour lui et une autre pour moi. Je me suis assis à ses côtés et ai essayé de m'évader une seconde fois, loin du bureau, loin des écrans, loin des pauvres types, loin des pauvres cons, loin de moi et au plus près d'un clochard. La magie n'opérait plus. Je n'étais plus Richards, je n'étais plus Hendrix, je n'étais plus Osbourne, je n'étais plus Morrison. J'étais juste moi, assis à côté d'un clochard une clope au bec. « Tu fais quoi dans la vie ? » m'a-t-il demandé entre deux bouffées. Je l'ai regardé avec un léger sourire. Sa question, aussi banale qu'elle pouvait paraître, m'avait propulsé dans une réflexion profonde sur mon existence. « Pour le moment, rien. Je ne fais absolument rien de ma vie. Et toi ? » lui ai-je retourné après un long moment d'absence. « Je survis. C'est ma façon de vivre. Je sais pourquoi je dois ouvrir les yeux chaque matin. » m'a-t-il rétorqué avant de faire des signes d'appels aux passants pour quelques pièces. De toute évidence, ce type aux chaussures trouées, au pantalon trop large et au manteau déchiré en savait beaucoup plus que moi sur le sens de la vie. Pour ma part, j'avais oublié pourquoi je devais ouvrir les yeux chaque matin. Ce mendiant voulait rester vivant au risque de se retrouver à l'écart de la troupe d'automates à laquelle j'appartenais bien malgré moi. Je l'admirais autant que je m'abhorrais. Il était courageux et je n'étais qu'un lâche qui se cachait derrière le confort d'une vie bien rangée. J'avais accepté de rester à la merci de mes geôliers.
Son genou ne cessait de s'agiter. Tout en continuant à le fixer, j'ai posé ma main et tapoté à deux reprises avec tendresse sur sa guibole tremblante, comme un geste de remerciement. Sous le regard hébété de ce brave type, je me suis levé, lui ai glissé mon paquet de clopes dans sa poche et lui ai dit avant de le quitter : « Je vais essayer de vivre, l'ami. »
C'était ma dernière cigarette et mon dernier acte de présence au troisième étage de cet immeuble haussmannien.
Il n'y avait pas un bruit dans le bureau, je n'étais pourtant pas le seul captif. Les écrans avaient pris le contrôle de tout l'étage. Les talons de mes boots claquaient sur le parquet et ce chuintement résonnait dans tout l'open space. Personne ne prenait le risque de lever la tête, il n'y avait que ces innombrables écrans qui semblaient pivoter dans ma direction, surpris de me voir en mouvement. J'ai ouvert l'immense porte typique de ces immeubles haussmanniens et emprunté l'escalier en chêne grinçant, tapissé de son étoffe rouge sanguinolent. En descendant les trois étages qui me menaient à la délivrance, je me suis pris à penser à tous ceux qui l'avaient arpenté avant moi. À ceux qui l'avaient gravi lors de leur premier jour et à ceux qui l'avaient dégringolé lors de leur dernier. À ceux qui l'avaient escaladé dans la réussite et à ceux qui l'avaient dévalé dans l'échec. Je me suis rapidement trouvé devant une seconde porte, encore plus imposante que la précédente, la dernière avant mon émancipation. Je l'ai ouverte en tirant de toutes mes forces pour me glisser sur le trottoir, contre le mur, afin d'éviter de perturber la circulation des Parisiens qui galopaient sous les coups de fouet de leur quotidien asservissant.
Mon paquet de cigarettes était encore vierge, je l'ai empoigné pour décrocher délicatement la languette de l'emballage plastique. Aucune poubelle à l'horizon, j'ai donc plongé le déchet dans la poche arrière gauche de mon pantalon dans l'attente de croiser un réservoir à ordures. Ensuite, c'était au tour du couvercle que j'ai soulevé avec plus d'empressement pour arracher d'un coup sec le dernier paquetage en aluminium. J'ai sorti la tige qui se trouvait au milieu du premier rang. Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier, aimais-je à penser. J'ai humidifié mes lèvres, porté la sèche empoisonnée à ma bouche en l'accompagnant d'un léger mouvement de tête vers la flamme libératrice de mon briquet. Une première taffe. J'ai inspiré profondément, coincé le nuage toxique dans mes poumons et exalté ce moment en expirant longuement. Je respirais enfin. J'ai repris vie et changé d'attitude. Je n'étais plus un mec soumis à son boulot, plus un esclave des machines et de leurs algorithmes. J'étais Richards, j'étais Hendrix, j'étais Osbourne, j'étais Morrison, j'envoyais le monde se faire foutre.
Un type est sorti de sa Porsche fraîchement garée, l'air hautain, il a porté son regard dédaigneux à mon endroit. Ses yeux m'ont dit : « Pauvre type, tu t'empoisonnes la santé pour supporter un boulot minable. » et les miens ont rétorqué : « Pauvre con, tu viens de te garer sur une place réservée aux handicapés. » Il est entré se faire lustrer dans la boutique d'à côté, c'était le genre de boutique où un tee-shirt coûtait la modique somme de 350 euros. Et puis, il y avait ce clochard adossé à la devanture du luxueux bazar. La mise en scène paradoxale typique que seul notre modèle de société pouvait réaliser. Il avait cette fierté bien placée qu'offrait la véritable modestie. Ce clochard a porté son regard empli d'espoir à mon encontre. Ses yeux m'ont dit : « Tu n'as pas une clope pour un pauvre type ? » et les miens ont rétorqué : « Je ne comprends pas ce que tu me veux. Je ne suis qu'un pauvre con. »
Ma cigarette avait déjà joué la moitié de sa pièce et j'avais décidé de me consacrer pleinement aux derniers actes. J'ai fermé les yeux pour faire abstraction du monde, je ressentais chacune de mes cellules pulmonaires se détériorer. Une aspiration. Le tabac se consumait comme la mèche d'une dynamite prête à exploser. Une taffe. Les picotements dans ma gorge m'épargnaient de la moindre parole superflue. Une bouffée. L'asphyxie progressive me redonnait un souffle de liberté. Un moment hors de l'espace et du temps. Il n'y avait ni bureau, ni écrans, ni pauvre type, ni pauvre con, ni clochard, ni même moi.
Le brûlant baiser du mégot atrophié m'a rappelé rapidement à ma situation. J'avais aspiré plus que la cigarette ne pouvait offrir. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvé à nouveau sur ce trottoir, contre le mur, face à la foule au dos lacéré. Le gars hautain était sorti de la boutique, hagard, il tournait sa tête dans tous les sens telle une buse aux aguets. La place réservée aux handicapés venait d'être débarrassée de sa Porsche. Il a porté son regard haineux en ma direction et ses yeux rougeoyants m'ont dit : « Tu aurais pu me prévenir, pauvre con. » et les miens ont rétorqué avec dédain : « Tu aurais mieux fait de te garer ailleurs, pauvre type. » Le mec à la Porsche s'est mis à courir après le camion de la fourrière en crachant des injures et en agitant ses bras tel un naufragé sur île déserte. Le clochard adossé à la devanture se marrait d'une manière si communicative qu'il m'avait extrait le premier sourire de la semaine. Nous étions vendredi. Vaut mieux tard que jamais, avais-je médité. Ses yeux, baignés par les larmes de l'euphorie, se sont portés vers moi et m'ont dit : « Bien fait pour sa gueule ! Dis, tu n'aurais pas une clope pour un pauvre type ? » et les miens ont rétorqué avec remords : « J'arrive. Fais donc une place pour un pauvre con. » J'ai sorti deux sèches de mon paquet, une pour lui et une autre pour moi. Je me suis assis à ses côtés et ai essayé de m'évader une seconde fois, loin du bureau, loin des écrans, loin des pauvres types, loin des pauvres cons, loin de moi et au plus près d'un clochard. La magie n'opérait plus. Je n'étais plus Richards, je n'étais plus Hendrix, je n'étais plus Osbourne, je n'étais plus Morrison. J'étais juste moi, assis à côté d'un clochard une clope au bec. « Tu fais quoi dans la vie ? » m'a-t-il demandé entre deux bouffées. Je l'ai regardé avec un léger sourire. Sa question, aussi banale qu'elle pouvait paraître, m'avait propulsé dans une réflexion profonde sur mon existence. « Pour le moment, rien. Je ne fais absolument rien de ma vie. Et toi ? » lui ai-je retourné après un long moment d'absence. « Je survis. C'est ma façon de vivre. Je sais pourquoi je dois ouvrir les yeux chaque matin. » m'a-t-il rétorqué avant de faire des signes d'appels aux passants pour quelques pièces. De toute évidence, ce type aux chaussures trouées, au pantalon trop large et au manteau déchiré en savait beaucoup plus que moi sur le sens de la vie. Pour ma part, j'avais oublié pourquoi je devais ouvrir les yeux chaque matin. Ce mendiant voulait rester vivant au risque de se retrouver à l'écart de la troupe d'automates à laquelle j'appartenais bien malgré moi. Je l'admirais autant que je m'abhorrais. Il était courageux et je n'étais qu'un lâche qui se cachait derrière le confort d'une vie bien rangée. J'avais accepté de rester à la merci de mes geôliers.
Son genou ne cessait de s'agiter. Tout en continuant à le fixer, j'ai posé ma main et tapoté à deux reprises avec tendresse sur sa guibole tremblante, comme un geste de remerciement. Sous le regard hébété de ce brave type, je me suis levé, lui ai glissé mon paquet de clopes dans sa poche et lui ai dit avant de le quitter : « Je vais essayer de vivre, l'ami. »
C'était ma dernière cigarette et mon dernier acte de présence au troisième étage de cet immeuble haussmannien.
© Short Édition - Toute reproduction interdite sans autorisation

Pourquoi on a aimé ?
Grâce à son humour, son amertume et sa gestion efficace de l’intrigue, cette histoire toute simple laisse entrevoir de nombreuses pistes de réflexion
Lire la suite

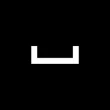
Pourquoi on a aimé ?
Grâce à son humour, son amertume et sa gestion efficace de l’intrigue, cette histoire toute simple laisse entrevoir de nombreuses pistes de réflexion