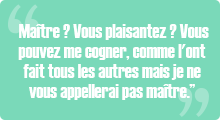« Maître ? Vous plaisantez ? Vous pouvez me cogner, comme l'ont fait tous les autres mais je ne vous appellerai pas maître ». Quatre heures du matin. Paris. Rue Jacob. Ces mots de Yamen Manaï me reviennent en tête. Je viens de finir de relire son dernier livre, Bel Abîme et ses phrases ne me quittent pas. Comme un leitmotiv qui me poursuit sans cesse. Dans l'appartement d'en face, des jeunes dansent et chantent. Si seulement... ; je me ressaisis : si seulement rien.
Un bruit sourd contre la porte. C'est lui, aucun doute là-dessus. Des pas s'enchaînent, il trébuche. Il atteint le lit et s'affale de tout son long. Il sent l'alcool ; le whisky plus précisément. Le lampadaire devant notre fenêtre éclaire son visage tuméfié et sa barbe de trois jours. Il se rapproche vers moi ; je me recule et place ma tête entre mes genoux ; soumission. Il me murmure des mots à l'oreille : « ma... toute... belle ». Avant, j'y croyais. J'y ai cru, et ce, longtemps. Jusqu'au jour où tout a basculé. A partir du moment où il a levé la main sur moi, rien ne fut plus pareil. Je me suis tue, persuadée que ce n'était qu'un accident, un geste involontaire ; parfois, l'alcool fait faire des choses aux antipodes de ce que l'on est vraiment. Mais en réalité, c'était le début d'une longue, très longue souffrance.
Je me décale sur le bord du lit. Il m'agrippe le bras et sert, il a de la poigne. J'ai mal. Doucement, j'essaye de retirer ma main ; je sais que, dans ces instants, il ne faut pas l'agacer – mais la pression est d'autant plus forte. Il faut que je sorte. Il est allé trop loin, mon bras me lance. Alors, sans prévenir, il me lâche et roule de l'autre côté. Les draps bruissent sous son corps. Dehors, les jeunes. Ils chantent. Il est quatre heures du matin et ils sont là, ensemble.
Je ne bouge pas, ne dis rien. Comme d'habitude, finalement. Comme depuis des années maintenant. Il se dirige vers la salle de bain. Ses pas sont lents ; il va vomir, c'est sûr. « Maître ? Vous plaisantez ? » Yamen Manaï est bouleversant. Son ouvrage, une ode à la vie. J'allume la lumière, attrape le livre sur la table de chevet et prends une page au hasard. Ses mots me font l'effet d'un bombe.
« J'entends par-ci par-là que dans notre cher pays, les femmes sont libres et libérées, mais on n'oublie guère de tresser dans la foulée les louanges de leur libérateur, de compléter par un "C'est grâce à Bourguiba". Je n'ai pas connu ce bonhomme. Il est mort bien avant ma naissance. Mais si c'est un homme qui a libéré toutes ces femmes, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes. Il fallait que ces femmes se libèrent elles-mêmes et d'elles-mêmes. »
Avidement, je lis, je bois ses paroles ; je suis transportée dans un autre monde, celui dans lequel je danserais sous une pluie torrentielle ; avec moi, ma sœur. Noûr, elle habite à deux rues d'ici. Mais depuis mon mariage avec lui, aucun contact ; pas une parole échangée. Elle avait dû comprendre que c'était un sale type. Maintenant, c'est trop tard. Rien n'est en mon pouvoir, et j'ai honte. Honte de ma situation, de ma personne et de mon corps. A l'école, un gamin m'a déjà fait la réflexion. « Maîtresse, c'est quoi sur ton bras ? Un tatouage ? » Ce n'était pas vraiment un tatouage, non ; c'était plutôt un bleu datant d'une semaine qui avait pris un ton verdâtre. Alors, pour éviter de tels problèmes, j'ai changé ma garde-robe ; adieu les jupes et les tee-shirt, bienvenue les pantalons et les manches longues.
Un râle s'échappe de sa bouche. Je l'entends de mon lit. Et maintenant, il m'appelle. Dehors, les jeunes et leur musique. Quel contraste avec ce qui se passe ici ! Sa voix se fait de plus en plus forte. J'ai peur pour les voisins ; je n'ai pas envie qu'iels alertent la police. Je soupire, encore et encore. Il crie. C'en est assez. Je me lève. Je n'allume pas la lumière, je ne veux pas voir le carnage. Il est penché sur la cuvette des toilettes, il a vomi. Je m'accroupis et, sans un mot, lui tends une serviette.
Noir.
« Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens. Bats-toi, signe et persiste » J'ouvre les yeux, doucement. Mes paupières se décollent difficilement, du sang a séché. La musique, provenant de l'appartement d'en face, me ramène dans le monde des vivants. Ou plutôt, dans mon cas, dans le monde des morts-vivants. Mais que s'est-il donc passé ? Je me souviens, les souvenirs remontent à la surface. Ma tête vers la sienne, mon bras sur le sien. Et puis son poing en plein dans mon visage. Je saigne abondamment.
Il est à côté de moi, couché en chien de fusil. Qu'ai-je donc fait à Allah pour mériter cette vie ? Les paroles de France Gall font leur chemin dans mon esprit. Tout à coup, comme mue par une force extérieure, je me redresse. Non. Non. Non. Plus jamais ça. Plus. Jamais.
Alors, je me dirige vers la table de chevet. Sans hésiter, ma main se pose sur Bel Abîme. Vite, un sac. Je tombe sur celui de mes vingt ans, offert par Julia et Samira. Elles me manquent. On s'était rencontrées lors de notre première année à l'université ; maintenant, elles aussi ont décroché le diplôme d'institutrice. Nous étions liées comme pas deux. « Si tu réalises que l'amour n'est pas là. Que le soir tu te couches. Sans aucun rêve en toi » Les garçons et les filles crient à tue-tête. Moi aussi j'ai envie de crier. De dire haut et fort que ma vie est détruite. De hurler que je ne veux plus de ce quotidien. De clamer que je n'attends qu'une chose, être libérée du carcan de cet homme. Malheureusement, il ne suffit pas d'attendre pour qu'un changement ne survienne.
Je cherche des yeux tout ce qui pourrait m'être utile en cas de crise. Je sais. La chaîne que j'avais reçue en guise de récompense lors de mon premier ramadan, il y a neuf ans. Et puis, en dernier lieu, mon carnet de poèmes et un crayon de papier. J'attrape un manteau, le premier qui me tombe sous la main ; je le repose aussitôt. C'était lui qui me l'avait offert. Rien de ce qui se rapporte à lui, de près ou de loin, ne doit m'accompagner.
Rapidement, j'enfile une vieille paire de chaussures. Ça fera l'affaire. Mes mains sont moites, je tremble. J'essaye tant bien que mal de nouer mes lacets. L'appartement est presque plongé dans le noir. Le silence est total. Je parcours du regard notre logement, maintenant, mon ancien chez-moi. Tout est à sa place, rien ne laisse transparaître toute la violence qui a pu être commise dans ces quelques mètres carrés. Je dis adieu à tout ce qui me tenait à cœur. La lampe qui a éclairé toutes les pages que j'ai lues ; la couverture dans laquelle je me suis blotti durant de longues heures ; le coussin que les larmes ont aspergé jour et nuit. Les relents de ma vie antérieure affleurent ; je les fais taire, c'est trop pour moi.
C'est terminé, c'était la dernière fois, et il n'y en aura pas d'autres. Je claque la porte. « Take me to the magic of the moment. On a glory night. Where the children of tomorrow dream away. In the wind of change » Scorpions. Décidément, tout est lié. Dans la nuit noire, l'air frais me fouette le visage. Au troisième étage, j'observe les jeunes qui continuent de danser et de chanter. Je me remets à marcher. J'ai pris ma décision, tout ceci est définitivement clos. Je renoue avec la vie.
Un bruit sourd contre la porte. C'est lui, aucun doute là-dessus. Des pas s'enchaînent, il trébuche. Il atteint le lit et s'affale de tout son long. Il sent l'alcool ; le whisky plus précisément. Le lampadaire devant notre fenêtre éclaire son visage tuméfié et sa barbe de trois jours. Il se rapproche vers moi ; je me recule et place ma tête entre mes genoux ; soumission. Il me murmure des mots à l'oreille : « ma... toute... belle ». Avant, j'y croyais. J'y ai cru, et ce, longtemps. Jusqu'au jour où tout a basculé. A partir du moment où il a levé la main sur moi, rien ne fut plus pareil. Je me suis tue, persuadée que ce n'était qu'un accident, un geste involontaire ; parfois, l'alcool fait faire des choses aux antipodes de ce que l'on est vraiment. Mais en réalité, c'était le début d'une longue, très longue souffrance.
Je me décale sur le bord du lit. Il m'agrippe le bras et sert, il a de la poigne. J'ai mal. Doucement, j'essaye de retirer ma main ; je sais que, dans ces instants, il ne faut pas l'agacer – mais la pression est d'autant plus forte. Il faut que je sorte. Il est allé trop loin, mon bras me lance. Alors, sans prévenir, il me lâche et roule de l'autre côté. Les draps bruissent sous son corps. Dehors, les jeunes. Ils chantent. Il est quatre heures du matin et ils sont là, ensemble.
Je ne bouge pas, ne dis rien. Comme d'habitude, finalement. Comme depuis des années maintenant. Il se dirige vers la salle de bain. Ses pas sont lents ; il va vomir, c'est sûr. « Maître ? Vous plaisantez ? » Yamen Manaï est bouleversant. Son ouvrage, une ode à la vie. J'allume la lumière, attrape le livre sur la table de chevet et prends une page au hasard. Ses mots me font l'effet d'un bombe.
« J'entends par-ci par-là que dans notre cher pays, les femmes sont libres et libérées, mais on n'oublie guère de tresser dans la foulée les louanges de leur libérateur, de compléter par un "C'est grâce à Bourguiba". Je n'ai pas connu ce bonhomme. Il est mort bien avant ma naissance. Mais si c'est un homme qui a libéré toutes ces femmes, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes. Il fallait que ces femmes se libèrent elles-mêmes et d'elles-mêmes. »
Avidement, je lis, je bois ses paroles ; je suis transportée dans un autre monde, celui dans lequel je danserais sous une pluie torrentielle ; avec moi, ma sœur. Noûr, elle habite à deux rues d'ici. Mais depuis mon mariage avec lui, aucun contact ; pas une parole échangée. Elle avait dû comprendre que c'était un sale type. Maintenant, c'est trop tard. Rien n'est en mon pouvoir, et j'ai honte. Honte de ma situation, de ma personne et de mon corps. A l'école, un gamin m'a déjà fait la réflexion. « Maîtresse, c'est quoi sur ton bras ? Un tatouage ? » Ce n'était pas vraiment un tatouage, non ; c'était plutôt un bleu datant d'une semaine qui avait pris un ton verdâtre. Alors, pour éviter de tels problèmes, j'ai changé ma garde-robe ; adieu les jupes et les tee-shirt, bienvenue les pantalons et les manches longues.
Un râle s'échappe de sa bouche. Je l'entends de mon lit. Et maintenant, il m'appelle. Dehors, les jeunes et leur musique. Quel contraste avec ce qui se passe ici ! Sa voix se fait de plus en plus forte. J'ai peur pour les voisins ; je n'ai pas envie qu'iels alertent la police. Je soupire, encore et encore. Il crie. C'en est assez. Je me lève. Je n'allume pas la lumière, je ne veux pas voir le carnage. Il est penché sur la cuvette des toilettes, il a vomi. Je m'accroupis et, sans un mot, lui tends une serviette.
Noir.
« Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens. Bats-toi, signe et persiste » J'ouvre les yeux, doucement. Mes paupières se décollent difficilement, du sang a séché. La musique, provenant de l'appartement d'en face, me ramène dans le monde des vivants. Ou plutôt, dans mon cas, dans le monde des morts-vivants. Mais que s'est-il donc passé ? Je me souviens, les souvenirs remontent à la surface. Ma tête vers la sienne, mon bras sur le sien. Et puis son poing en plein dans mon visage. Je saigne abondamment.
Il est à côté de moi, couché en chien de fusil. Qu'ai-je donc fait à Allah pour mériter cette vie ? Les paroles de France Gall font leur chemin dans mon esprit. Tout à coup, comme mue par une force extérieure, je me redresse. Non. Non. Non. Plus jamais ça. Plus. Jamais.
Alors, je me dirige vers la table de chevet. Sans hésiter, ma main se pose sur Bel Abîme. Vite, un sac. Je tombe sur celui de mes vingt ans, offert par Julia et Samira. Elles me manquent. On s'était rencontrées lors de notre première année à l'université ; maintenant, elles aussi ont décroché le diplôme d'institutrice. Nous étions liées comme pas deux. « Si tu réalises que l'amour n'est pas là. Que le soir tu te couches. Sans aucun rêve en toi » Les garçons et les filles crient à tue-tête. Moi aussi j'ai envie de crier. De dire haut et fort que ma vie est détruite. De hurler que je ne veux plus de ce quotidien. De clamer que je n'attends qu'une chose, être libérée du carcan de cet homme. Malheureusement, il ne suffit pas d'attendre pour qu'un changement ne survienne.
Je cherche des yeux tout ce qui pourrait m'être utile en cas de crise. Je sais. La chaîne que j'avais reçue en guise de récompense lors de mon premier ramadan, il y a neuf ans. Et puis, en dernier lieu, mon carnet de poèmes et un crayon de papier. J'attrape un manteau, le premier qui me tombe sous la main ; je le repose aussitôt. C'était lui qui me l'avait offert. Rien de ce qui se rapporte à lui, de près ou de loin, ne doit m'accompagner.
Rapidement, j'enfile une vieille paire de chaussures. Ça fera l'affaire. Mes mains sont moites, je tremble. J'essaye tant bien que mal de nouer mes lacets. L'appartement est presque plongé dans le noir. Le silence est total. Je parcours du regard notre logement, maintenant, mon ancien chez-moi. Tout est à sa place, rien ne laisse transparaître toute la violence qui a pu être commise dans ces quelques mètres carrés. Je dis adieu à tout ce qui me tenait à cœur. La lampe qui a éclairé toutes les pages que j'ai lues ; la couverture dans laquelle je me suis blotti durant de longues heures ; le coussin que les larmes ont aspergé jour et nuit. Les relents de ma vie antérieure affleurent ; je les fais taire, c'est trop pour moi.
C'est terminé, c'était la dernière fois, et il n'y en aura pas d'autres. Je claque la porte. « Take me to the magic of the moment. On a glory night. Where the children of tomorrow dream away. In the wind of change » Scorpions. Décidément, tout est lié. Dans la nuit noire, l'air frais me fouette le visage. Au troisième étage, j'observe les jeunes qui continuent de danser et de chanter. Je me remets à marcher. J'ai pris ma décision, tout ceci est définitivement clos. Je renoue avec la vie.